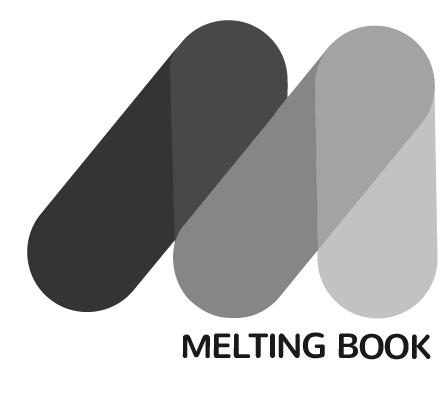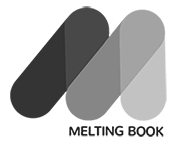Les sans-papiers ou le retour du refoulé colonial
Les sans-papiers d’Aubervilliers c’est une vieille histoire qui dure depuis l’automne dernier. Six mois que ces quarante quatre originaires de Côte d’Ivoire pour la plupart, tentent de se faire entendre. Demandeurs d’asile, la situation est bloquée et des intimidations se multiplient. Parcours classique : la Libye, l’Italie, La France.
Après s’être installés avec leurs valises sur la place de la mairie, sans véritable dialogue, avoir été hébergés par le Théâtre La Commune pendant quinze jours, ils occupent actuellement un espace provisoire d’où les promoteurs comptent bien les expulser par tous les moyens.
L’explosion urbaine d’Aubervilliers conduit les politiques de la ville à privilégier l’urbanisme, au lien social et humain, laissant les Bouygues et consorts raser les traces de l’histoire de la ville.
On est en droit de se demander à la lumière de ce refus de prendre en compte une question éminemment politique, si les responsables politiques de la ville ont une réelle autonomie quant au lien social qu’ils affirment défendre.
Trop symbolique pour s’effacer des mémoires, l’évacuation des sans-papiers de l’église Saint-Bernard, à Paris, le 23 août 1996, a aussi été l’acte fondateur d’un mouvement qui, depuis, a pris son autonomie.
Car en deux décennies, la lutte des sans-papiers a largement changé de forme.
Adieu les occupations d’églises.
« Aujourd’hui, le rapport de force se joue sur le lieu de travail. Cela a commencé en 2008 et cela s’étend depuis », explique Maryline Poulain, en charge des questions d’immigration à la CGT Paris.
Son syndicat a appuyé, en juin, les salariés du restaurant Casa Luca à Paris, occupé à la suite du licenciement d’un de ses deux plongeurs.
Après cinq ans d’ancienneté, il avait eu le tort de solliciter de sa direction le certificat nécessaire à l’obtention de son titre de séjour.
Tous les patrons n’acceptent pas de payer la taxe de régularisation, ni même de faire la démarche,» peut-on lire dans le journal Le Monde.
À Aubervilliers, ils sont loin d’avoir tous du travail.
Sans papiers signifie sans travail.
Ibrahim est arrivé en France avec pour s’en sortir son art . Il est « mage » échassier. Il se démène pour exister à travers son savoir-faire. Il cherche à s’élever au-dessus des affres de ce monde.
Aboubakar faisait de la philosophie en Côte d’Ivoire. À Paris 8, on n’a rien voulu entendre.
Un sans papier est condamné à l’invisibilité.
Mamadou croit au pouvoir du temps, lui qui a pris le bateau et a vu des proches périr pendant la traversée en mer.
Le refoulé de la colonisation
Ces multiples départs pour la France ne sont pas insignifiants. Mamadou raconte qu’en Italie il ne comprenait rien.
Le français en revanche, il connaît bien. Propos tout à fait convaincants dans la mesure où la Côte d’Ivoire fut une colonie française.
On ne retire pas du jour au lendemain les rapports de colonisé à colonisateur.
Frantz Fanon écrivit Les Damnés de la terre, en 1961. Il y montre la puissance et la symbolique de la division des espaces, division que l’on retrouve dans l’occupation des « squats » par les sans-papiers.
EXTRAIT : » La zone habitée par les colonisés n’est pas complémentaire de la zone habitée par les colons. Ces deux zones s’opposent, mais non au service d’une unité supérieure.
Régies par une logique purement aristotélicienne, elles obéissent au principe d’exclusion réciproque : il n’y a pas de conciliation possible, l’un des termes est de trop.
La ville du colon est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C’est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés.
Les pieds du colon ne sont jamais aperçus, sauf peut- être dans la mer, mais on n’est jamais assez proche d’eux. Des pieds protégés par des chaussures solides alors que les rues de leur ville sont nettes, lisses, sans trous, sans cailloux.
La ville du colon est une ville repue, paresseuse, son ventre est plein de bonnes choses à l’état permanent. La ville du colon est une ville de blancs, d’étrangers.
La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la médina, la réserve est un lieu mal famé, peuplé d’hommes mal famés.
On y naît n’importe où, n’importe comment.
On y meurt n’importe où, de n’importe quoi. C’est un monde sans intervalles, les hommes y sont les uns sur les autres, les cases les unes sur les autres.
La ville du colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande, de chaussures, de charbon, de lumière. La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée.
C’est une ville de nègres, une ville de bicots. Le regard que le colonisé jette sur la ville du colon est un regard de luxure, un regard d’envie.
Rêves de possession. Tous les modes de possession : s’asseoir à la table du colon, coucher dans le lit du colon, avec sa femme si possible. Le colonisé est un envieux.
Le colon ne l’ignore pas qui, surprenant son regard à la dérive, constate amèrement mais toujours sur le qui-vive : « Ils veulent prendre notre place. »
C’est vrai, il n’y a pas un colonisé qui ne rêve au moins une fois par jour de s’installer à la place du colon. »
Il y a déplacement du lieu dans ce jeu de retour à la colonisation… mais le colon est toujours le même. Le colonisé aussi.
Si cette distinction se marque spatialement, elle attend une assimilation dans l’impératif de maîtriser la langue du pays d’arrivée.
À l’exilé, on impose des racines dans le non lieu de l’intégration.
Les sans-papiers rencontrés ce jour-là étaient regroupés autour d’un arbre dont les racines sortaient du sol. C’était comme si l’arbre montrait la fragilité de l’homme attaché à ses racines.
L’exil, c’est la révélation finalement de la fragilité de cette volonté de s’attacher à un sol.
Enée portait sa patrie sur le dos, son propre père, ne la déposant que dans un acte de fatigue, et de violence vis à vis de ce sol qui n’était à personne, jusqu’à ce qu’il s’en empare et s’y installe.
Toute colonisation garde ainsi en mémoire l’acte violent initial. Les sans-papiers sont des hommes qui rappellent à la mémoire ce refoulé occidental.
Danse, transe, rire
Il y avait beaucoup de musique aux sonorités diverses, associant la tradition à la modernité.
Le rythme des corps se soumettait aux percussions, dans un va et vient proche de la transe mystique et de la sexualité, elle aussi refoulée.
Et tout le monde riait – ou presque, certains ayant le regard songeur, imperméable. On partageait un repas, à base de fruits, de légumes, d’épices, dans cet inconscient retour à l’imaginaire frugal africain. Ce rire on pourrait le qualifier d’échappatoire au sanglot de l’homme noir.
De la danse au rire planait cette ambiguïté de l’esprit colonial renforçant la division spatiale.
Ibrahim avait bien compris. Dansant du haut de ses échasses, il attendait le billet qui justifierait de montrer son courage, par une pirouette. Cela n’eut pas lieu.
Ils n’y connaissent rien, confia-t-il. Lui avait compris le poids de l’argent pour sortir de cette condition. Il se mit un chapeau et sortit de cet espace qu’il n’aimait pas. Il rêvait d’être artiste. Peut-être parce que l’art de l’échassier est de surplomber le sol et les racines.
Maryse Amel
Maryse Emel est professeure de philosophie. Elle participe activement à des actions culturelles à Aubervilliers où elle défend une autre vision de ce que l’on désigne du terme de « banlieue ». Elle est également rédactrice à nonfiction.fr.