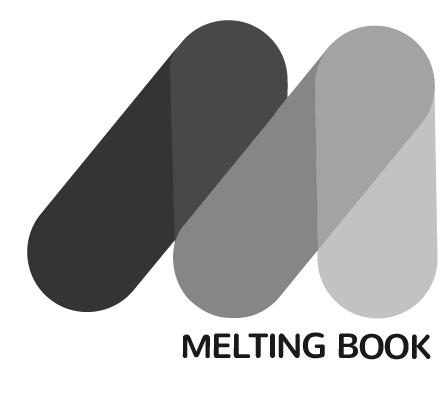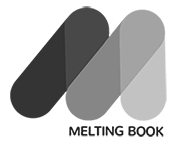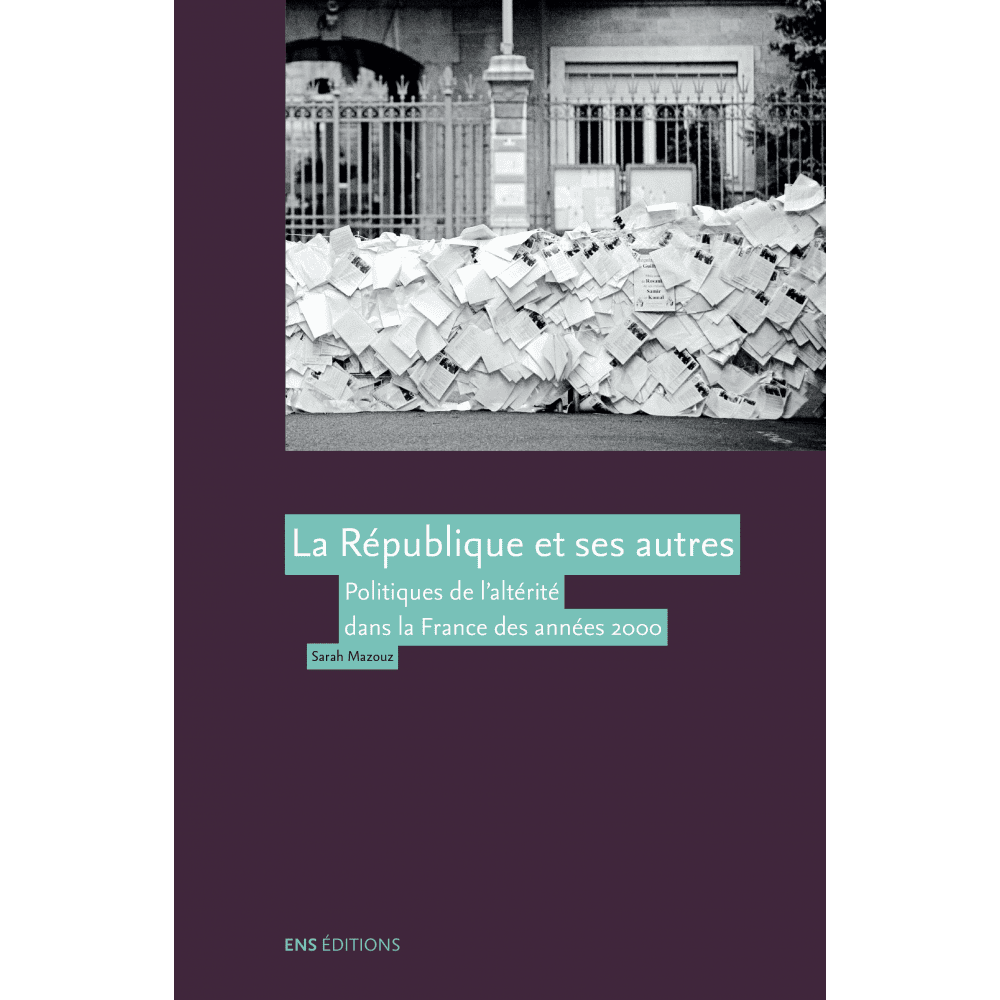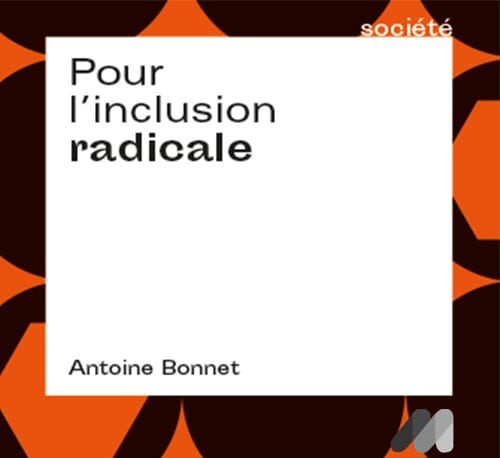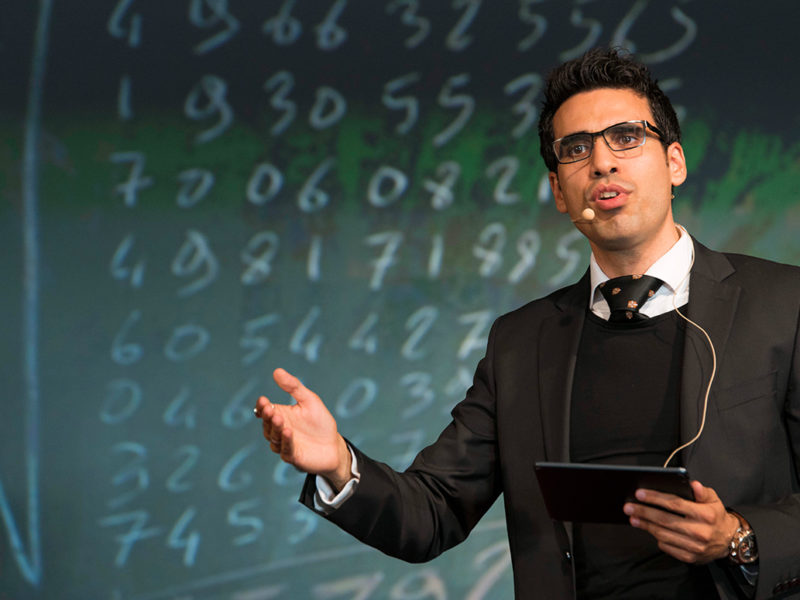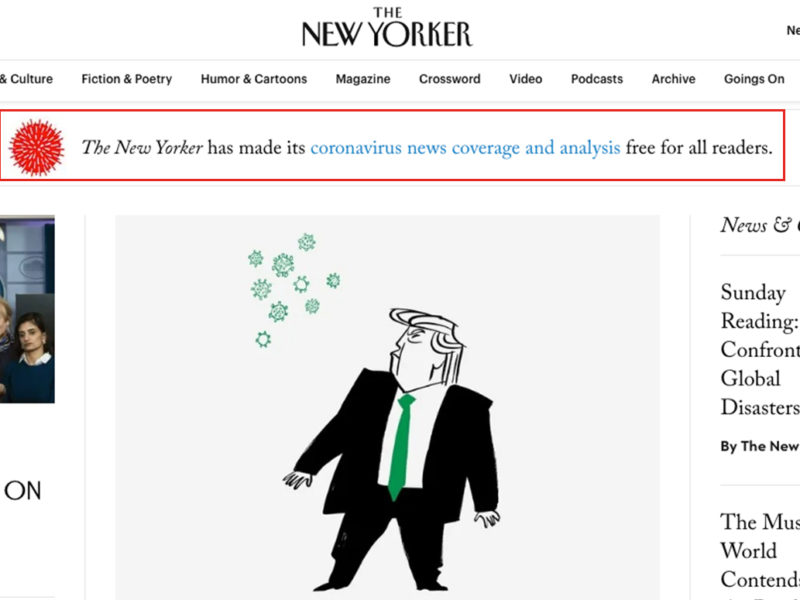“Les dynamiques de racialisation sont tues par les pouvoirs publics”
La sociologue, Sarah Mazouz publie La République et ses autres. Politiques de l’altérité dans la France des années 2000, Lyon ENS Éditions. Elle revient dans un long format sur l’enjeu clé de l’altérité dans la société française.
Vous êtes l’auteure de « La République et ses autres. Politiques de l’altérité dans la France des années 2000 » paru en mars dernier chez ENS Éditions. Pouvez-vous revenir sur le concept de « politiques de l’altérité » ?
Sarah Mazouz : Par « politiques de l’altérité », j’entends les discours et les pratiques qui formalisent la manière dont la République administre celles et ceux défini.e.s comme autres, qu’il s’agisse d’étrangers sollicitant la nationalité française, de personnes naturalisées ou plus généralement de citoyens français racialisés.
Justement, beaucoup ne comprennent pas ou réfutent l’idée d’une société française « racialisée ». Qu’en pensez-vous ?
S. M. : La question de la racialisation est au cœur de mon travail. J’utilise cette notion parce qu’elle permet de voir comment une société produit du racial à un moment et dans un contexte donnés.
Quand je dis « racial », j’entends par là un rapport de pouvoir spécifique produit socialement – comme la classe ou le genre. Ces processus de racialisation varient d’une époque à l’autre mais ils permettent dans le cas d’une société donnée de placer certains de ses membres dans une position inférieure ou subalterne en justifiant cela par l’altérité – supposée radicale – de leur origine.
Donc parler de racialisation, cela permet de mettre en évidence des processus qui changent d’une époque à une autre, qui ne visent pas toujours les mêmes groupes, mais qui concourent systématiquement à leur infériorisation.
C’est aussi une notion qui sert à voir comment le racisme a sédimenté dans les catégories de perception, même chez des personnes qui n’adhèrent pas activement à une idéologie raciste, et comment il peut continuer d’influer sur la manière dont certain.e.s sont perçu.e.s et, de ce fait, assigné.e.s.
Ce terme de « racialisation » est, pourtant, souvent au cœur de controverses…
S. M. : C’est un terme que je revendique. C’est tout l’enjeu de mon travail de l’introduire. C’est en montrant comment les processus de racialisation sont à l’œuvre que j’analyse l’échec de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’existence des discriminations raciales en France.
C’est aussi en m’appuyant sur cette notion que je m’efforce d’éclairer la manière dont certaines pratiques d’octroi de la nationalité française dans la procédure de naturalisation peuvent reposer sur une conception racialisée de l’appartenance nationale.
Votre travail s’intéresse aux politiques de lutte contre les discriminations. Vous dépassez le cadre de ce refus du droit en pointant « l’assignation racialisante ». De quoi s’agit-il ?
S. M. : En effet, une discrimination, c’est le refus d’accès à un droit. Dans mon travail, je me suis attachée à saisir aussi ce qui se passe dans les interactions sociales en amont ou à côté de cette seule question.
C’est pour cela que j’ai recours à l’expression d’ « assignation racialisante ». J’entends par là le fait pour un individu de se voir ramené et réduit à ce que d’autres que lui pensent être le trait pertinent qui le caractérise.
Pour rendre les choses plus parlantes, je vais prendre le cas d’une personne rencontrée pendant mon enquête de terrain. Il s’agit d’une attachée de préfecture chargée de mission « égalité des femmes ».
Elle porte un nom nord-africain. Et, comme elle l’explique dans l’extrait d’entretien que je cite en ouverture de l’ouvrage, elle se trouve constamment confrontée à des réactions de la part de ses collègues qui laissent entendre qu’elle ne serait rien d’autre qu’une femme d’origine arabo-musulmane.
Par exemple, lors d’une réunion, on va se tourner vers elle pour avoir son expertise quand il s’agit, non pas de son domaine de compétence – l’égalité hommes/femmes –, mais sur l’abattage des moutons pendant l’Aïd el-Kébir.
Elle explique aussi comment, à l’inverse, son nom amène certain.e.s à mettre en doute son impartialité quand elle défend des femmes sans-papiers, alors même que cela entre dans le cadre de ses missions.
Vous voyez, subir une assignation, c’est voir choisir par celles et ceux qui font partie du groupe dominant, la caractéristique qui est censée vous définir et s’y référer pour expliquer tout ce que vous faites.
En ce sens, une assignation est une réduction et, dans le cas de l’ « assignation racialisante », il s’agit d’une réduction à ce que l’on suppose être votre origine.
Vous avez mené une enquête de terrain longue. Pourriez-vous revenir dessus et nous dire ce qu’au terme de ce travail, vous avez vu de la façon dont « l’autre » est perçu par l’administration française?
S. M. : C’est une enquête ethnographique, c’est-à-dire que j’ai procédé par immersion longue (souvent plusieurs mois d’affilée) dans les institutions que j’étudiais.
Comme je le disais précédemment, j’avais comme entrée deux politiques différentes : la lutte contre les discriminations raciales et la naturalisation.
J’ai donc mené des observations répétées dans une préfecture de la région parisienne. J’ai suivi les différentes activités de la Commission pour la promotion de l’égalité des chances et la citoyenneté, le dispositif de l’État visant à sensibiliser et à mobiliser contre les discriminations.
J’ai aussi réalisé des observations au sein du Bureau des naturalisations de cette même préfecture, notamment en assistant aux entretiens d’assimilation linguistique que tou.te.s les postulant.e.s à la naturalisation passent et aux cérémonies de remise des décrets de naturalisation.
Ces différentes observations ont été complétées par des entretiens réalisés avec des hauts-fonctionnaires, des élus, des fonctionnaires de préfecture, des naturalisé.e.s et des personnes susceptibles d’être victimes de discriminations raciales.
Grâce à l’immersion longue dans une institution, le choix de la méthode ethnographique m’a aussi permis de voir les pratiques dans leur complexité puisque l’on observe les gens, en train de travailler.
On peut ainsi mettre en relation ce qu’ils disent avec ce qu’on les voit faire et ce que l’on apprend des conditions de travail dans tel ou tel service.
Or ce que j’ai pu constater pendant cette enquête, aussi bien du côté des politiques de lutte contre les discriminations raciales que de celui de la naturalisation, c’est une difficulté à saisir la question de la racialisation.
Cela produit une situation très ambivalente.
C’est-à-dire ?
S. M. : Du côté de l’anti-discrimination, la dimension raciale de ce type d’inégalité n’est pas nommée et donc ce qui est censé faire l’objet d’une reconnaissance est en fait maintenu dans le non-dit.
En revanche, du côté de la procédure de naturalisation, on peut assister à des pratiques bureaucratiques qui mettent en acte une conception univoque et parfois racialisée de l’appartenance à la nation.
Quand je dis « une conception univoque et parfois racialisée » de la nation, je veux dire par là qu’aux yeux de certains agents du Bureau des naturalisations il n’y aurait qu’une seule façon légitime d’être français.
Et le plus souvent cette conception repose sur l’idée d’une francité blanche menacée par l’islam. Cela se décline bien sûr différemment selon les services et les agents.
Mais, par exemple, sur la question de la blancheur : aussi bien dans les interactions que j’ai pu observées, lors de la procédure de naturalisation que dans les entretiens que j’ai réalisés avec des naturalisé.e.s, comment la capacité à parler français des personnes venant de pays d’Afrique subsaharienne était systématiquement remise en doute alors même que leur pays d’origine était francophone et qu’elles parlaient français comme vous et moi.
En revanche, dans le cas d’une personne blanche originaire du Canada anglophone et ayant appris le français sur le tard, la question de sa connaissance du français n’a pas fait l’objet de discussion.
Lors des cérémonies de remise des décrets de naturalisation, les commentaires qui sont donnés de la devise nationale par les représentant.e.s de l’État laissent en outre le plus souvent entendre le doute qui pèse sur celles et ceux qui seraient musulman.ne.s.
De nombreux discours rappellent ainsi, comme j’ai pu l’entendre à plusieurs reprises lors de cérémonies organisées en préfecture, que certain.e.s naturalisé.e.s viennent de cultures où l’égalité hommes/femmes n’est pas assurée, et lorsque le caractère laïc de l’État est présenté, il arrive très souvent que le regard de l’orateur se porte de manière insistante sur les quelques femmes voilées présentes à la cérémonie, un peu comme si leur comportement menaçait ce principe.
Cette vision de l’appartenance nationale peut aussi se formuler à travers des jugements moraux, portant sur la dignité ou le mérite des postulants à devenir français.
Par exemple, cela apparaît dans le discours des agents du bureau des naturalisations quand ils parlent des cas de polygamie – dont on peut se demander, au passage, s’il ne s’agit pas d’une question à présent largement fantasmée puisque tout au long de mon enquête, je n’ai pas vu une seule fois une demande de naturalisation présentant un cas de polygamie.
En tout cas, les co-épouses de polygames figurent dans le discours de nombreux agents une forme d’arriération sociale qui les séparerait radicalement de ce que serait une femme française. Or le registre moralisateur sur lequel s’appuient ces discours sert aussi à racialiser ces femmes comme noires et comme musulmanes, tout à la fois en les minorisant et en les altérisant.
On pourrait aussi prendre l’exemple – qui ne fait pas objet de controverses– des jugements de valeurs portés par les agents sur les diplômes universitaires obtenus par les postulant.e.s dans leur pays d’origine.
Ces diplômes, comme l’ensemble du système scolaire et universitaire, font l’objet de disqualifications quasi systématiques de la part des agents.
Or certains malentendus mettent en lumière la méconnaissance qu’ont certains agents des systèmes étrangers de formation. Par exemple, dans le cas de postulant.e.s originaire d’Inde, du Pakistan ou du Bangladesh arrivé.e.s au niveau de la licence – dont la dénomination anglaise est « college » – les agents que j’ai observés notaient systématiquement que ces postulant.e.s avaient arrêté leurs études en 3e.
Cette confusion met certes en lumière l’ignorance dans laquelle sont les agents de la différence de sens qui existe entre le terme « college » et « collège ».
Mais, les commentaires par lesquels certains d’entre eux répondaient aux postulants qui tentaient de leur expliquer que cela ne désignait pas le même niveau d’études pouvaient laisser aussi entendre une franche condescendance à l’égard des diplômes délivrés dans ces pays.
Vous définissez un concept « le républicanisme minoritaire ». Pouvez-vous expliquer sur quoi il repose et comment il opère dans les politiques de naturalisation et de lutte contre les discriminations ?
S. M. : Par « républicanisme minoritaire », j’entends une posture qui dépasse le seul cadre de la lutte contre les discriminations raciales ou de la naturalisation. Je désigne par là un positionnement que j’ai rencontré chez des personnes soumises à des formes d’assignation racialisante et travaillant dans des instituions publiques directement ou non sur la question des discriminations raciales.
Toutes affirment leur engagement à lutter contre les discriminations raciales, mais elles doivent sans cesse donner des gages de leur adhésion à l’idéologie républicaine.
C’est pour cela qu’elles sont constamment en tension entre leur volonté d’agir contre ce type d’inégalité et celle de rester conformes à l’idéal d’universalisme abstrait.
Par exemple, tou.te.s insistent sur leur opposition à la mise en place de politiques d’action positive qu’elles assimilent, comme souvent dans le discours politique et médiatique en France, à une politique des quotas qui viendrait rompre à leur sens l’homogénéité du corps politique et social.
Certains d’entre elles s’attachent aussi à montrer que leur engagement sur ces questions n’a pas de lien avec leur propre expérience de l’ « assignation racialisante ».
En revanche, la dimension symbolique que recèle leur recrutement à tel ou tel poste leur paraît dans la majorité des cas porteuse de sens. À leurs yeux, avoir été choisi constitue en effet la preuve de pratiques de recrutement ou de nomination non discriminatoires.
Or, c’est là qu’ils se retrouvent dans une situation paradoxale puisqu’ils refusent la mise en œuvre de mesures antidiscriminatoires générales ciblant des groupes au nom du principe d’égalité formelle et de l’exigence d’universalisme abstrait.
Mais, ils acceptent néanmoins d’être spécifiquement choisi pour donner un gage de… colorblindness.
Avez-vous l’impression qu’aujourd’hui d’autres types de positionnement émergent ? On a par exemple l’impression que les groupes dits « racisés » tentent de palier eux-mêmes les déficiences de l’État…
S. M. : En effet, par rapport au moment où j’ai conduit mon enquête de terrain, on voit aujourd’hui que des groupes qui se revendiquent comme racisés prennent la parole au nom de cette expérience d’assignation.
Je ne dirais pas que ces groupes pallient les déficiences de l’État – ce n’est pas leur fonction – mais ils permettent une reconfiguration du débat sur les questions d’égalité et de pluralisme de la société française nécessaire et salutaire !
Dans le processus d’explicitation, les choses avancent donc du côté de la société civile. En revanche, du côté des pouvoirs publics, la question des dynamiques de racialisation, qui sont à l’œuvre dans la société française, et de ce qu’elles produisent comme forme d’expérience minoritaire continue d’être tues et même enfouies.
Cet enfouissement pouvait déjà s’observer au moment même où était censé s’opérer la reconnaissance des discriminations raciales en France.
Quand nous sommes passés des Commissions départementales d’accès à la citoyenneté (CODAC) à celles pour la promotion de l’égalité des chances et la citoyenneté (COPEC), les dispositifs ont été élargis à toutes les formes de discriminations.
Cet élargissement a permis d’évacuer complètement la question des discriminations raciales des discussions qui avaient lieu dans ces dispositifs. Cela a donc maintenu dans le non-dit les processus de racialisation.
Et la reconnaissance des formes d’inégalité que ces processus concourent à produire n’a pas eu lieu. C’est la raison pour laquelle j’ai repris la notion de « secret public » à l’anthropologue américain Michaël Taussig pour décrire comment ces processus de racialisation sont passés sous silence alors même que tout le monde sait qu’ils existent et qu’ils agissent.
Comment expliquez-vous cette libération de la parole chez les racisés et en même temps cette forte crispation dans le débat public ?
S. M. : Sans doute qu’une brèche a été progressivement ouvert, ce qui fait que les générations qui prennent la parole aujourd’hui sur le plan politique et militant ne se positionnent plus de la même façon que celles qui les ont précédées.
On ne peut plus dire à des jeunes dont les parents ou même les grands-parents sont nés en France : « vous n’êtes pas de vrais Français » ou les ramener à une position subalterne en s’appuyant sur des catégories de perception parfois héritées de l’époque coloniale.
On voit sûrement aussi l’effet de formations offertes par certaines universités qui ont rendu possible la circulation et l’appropriation de textes issus de courants de recherche comme les Critical Race Studies aux Etats-Unis ou les études post-coloniales par exemple. Ces travaux, comme les études de genre, mettent à disposition des outils conceptuels qui permettent la thématisation et la formulation politiques de revendications minoritaires.
Et ces revendications se trouvent d’ailleurs souvent à l’intersection des luttes féministes et de celles contre les formes d’ « assignation racialisante », comme on le voit avec l’émergence de groupes afro-féministes.
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que des crispations apparaissent du côté du groupe majoritaire, en tout cas dans certaines de ses franges qui voit remis en cause le rapport de pouvoir qui lui profite.
C’est inquiétant parce que l’on assiste à une sorte de retour de bâton où des propos racialisants se diffusent et se banalisent en disqualifiant toujours plus fortement les revendications venant des groupes racialisés.
Mais, dans le même temps – et c’est peut-être là mon optimisme qui parle – c’est le signe que les choses bougent et que les personnes racialisées ont pris la parole. Leur condition ne peut plus être passée sous silence et délégitimée comme elle l’était il y a encore peu.
Finalement, ces nouvelles générations « racialisées » réinventent aussi une certaine idée de la francité ?
S. M. : Oui, tout à fait !
L’un des sujets par lequel la discorde et les bouleversements sont arrivés est l’islam, décrit comme un risque pour ce principe républicain. Etes-vous d’accord ?
Ces dernières années, l’islam est l’un des principaux objets de controverses politico-médiatiques en France. C’est un épouvantail que l’on agite facilement dès que l’on veut faire peur.
Au-delà de ces polémiques, il y a, comme je le disais précédemment en parlant de certains aspects de la procédure de naturalisation, une focalisation sur l’islam et les musulman.ne.s, avec l’idée que c’est ce qui menace les principes de la République.
Il y a presque vingt ans, en 1998, le Haut Conseil à l’Intégration publiait un rapport sur la lutte contre les discriminations. Le 16 novembre 2001, la loi contre les discriminations est votée. Dans le même temps, on a promu la fameuse « diversité ». Et depuis quelques années, plus rien. L’Etat semble avoir évacué cette question. Pourquoi selon vous ?
S. M. : Cette loi n’est pas l’effet de ce rapport mais le résultat de la mise en conformité du droit français avec la directive européenne dite « Race ». Il s’agit là de deux processus distincts même s’ils ont lieu dans cette période de vaste reconnaissance de la question des discriminations raciales par les pouvoirs publics français. Le rapport du HCI manifeste cette reconnaissance plus qu’il ne la produit.
Vous parlez de « non-lieu » des politiques publiques en matière de discriminations…
S. M. : Le mouvement de reconnaissance lancé en France à la fin des années 1990 a très vite été entravé pour aboutir finalement à une sorte de non-lieu.
C’est ce que je décris dans les deux premiers chapitres de mon ouvrage. Quand la question des discriminations raciales émerge et que les premiers dispositifs de lutte sont créés, notamment après le discours que Martine Aubry prononce devant le Conseil des ministres le 21 octobre 1998, la lutte contre les discriminations raciales est pensée comme l’instrument qui va permettre de donner un souffle nouveau à la politique de promotion de l’intégration.
Lier la lutte contre les discriminations et la promotion de l’intégration est problématique selon vous. Pourquoi ?
S. M. : Oui, lier les deux politiques est problématique et cela au moins à deux titres.
D’abord, parce que ces deux types de politiques ne se fondent pas sur les mêmes présupposés pour réaliser plus d’égalité. Pour une lecture en termes d’intégration, c’est aux individus de s’adapter au système et cela amène à considérer que leurs différences sont un vecteur principiel d’inégalité et qu’il faut progressivement les effacer.
Quand on analyse les choses par le biais des discriminations, on fait porter le regard sur les obstacles produits par la société et l’enjeu est de trouver les leviers qui permettent de produire plus d’égalité, au-delà de la seule formulation du principe d’égalité formelle.
Donc, vous voyez, penser la lutte contre les discriminations comme l’instrument d’une politique de promotion de l’intégration, c’était déjà prendre le risque de la dénaturer.
Et c’est ce qui s’est passé dans certains dispositifs de l’États : les observations que j’ai pu faire au sein d’une COPEC de la région parisienne mettaient en lumière une non-appropriation des apports d’une analyse des rapports sociaux en termes de discrimination.
Par exemple, les responsables des groupes de réflexion de cette commission considéraient qu’il suffisait de rappeler les droits existants en laissant clairement entendre que c’était aux individus d’identifier le tort qu’ils ont subi, de saisir les autorités compétentes et ainsi de prendre en charge la mise en acte du droit.
Or une telle lecture rate en fait l’apport introduit par le principe de non-discrimination, qui ne se contente pas de constater que les droits sont également garantis à toutes et à tous mais qui pose la question de la traduction réelle de ce principe d’égalité.
Donc cette première mécompréhension explique en partie l’échec de la lutte contre les discriminations.
Ensuite, le fait d’avoir lié lutte contre les discriminations et promotion de l’intégration a aussi fait percevoir l’anti-discrimination comme une grille de lecture concurrente de la promotion de l’intégration qui menaçait de ce fait l’expertise que certain.e.s s’étaient forgée en la matière.
Il y a eu donc des formes de résistance à cette nouvelle grille de lecture – de la part de certains fonctionnaires ou haut-fonctionnaires ou même chez certains membres du cabinet de Martine Aubry à l’époque.
Enfin, l’anti-discrimination a pu aussi apparaître dans certains cas comme une cause concurrente de l’anti-racisme. C’est ce qui explique les réticences – du moins dans un premier temps – à l’adoption de ce type d’analyse des rapports sociaux par les grandes associations antiracistes comme SOS-Racisme par exemple.
A contrario, c’est le secteur privé avec La Charte de la diversité, lancée par Claude Bébéar, fondateur d’AXA, qui a été le fer de lance sur le sujet…
S. M. : Certes, mais cela arrive plus tard, au milieu des années 2000 et l’introduction de la thématique de la diversité participe aussi au mouvement d’effacement de la question des discriminations.
Cette notion sert une occultation des discriminations d’abord parce qu’elle désigne une situation où les discriminations n’existeraient plus et qu’elle la présente comme atteinte.
De ce fait, comme l’ont montré les travaux de Laure Bereni, d’Alexandre Jaunait ou de Milena Doytcheva, les discours sur la diversité ont conduit à gommer l’idée qu’il y a un rapport de pouvoir entre groupes majoritaires et groupes minoritaires.
Ils cachent ainsi les formes de conflits qui existent – et que l’anti-discrimination analyse et met en lumière – et ils évacuent la question de la racialisation.
C’est aussi un discours qui fait usage de notions empruntées au droit et aux sciences sociales comme celles de « discrimination systémique » ou de « discrimination indirecte » pour effacer la figure du perpétrateur de discrimination ou pour passer sous silence les termes, comme « racisme », « sexisme » ou « homophobie », qui montrent le caractère moralement répréhensible des discriminations.
La diversité est-t-elle devenue un outil cosmétique ? Qu’en pensez-vous ?
S. M. : L’introduction du discours sur la diversité a permis ce que en sciences sociales on appelle la « managérialisation » de l’anti-discrimination.
Les entreprises se sont appropriées la référence à l’anti-discrimination parce qu’elle renforce leur image et leur légitimité en leur permettant d’afficher leur respect des obligations juridique.
Mais, en remplaçant la référence directe à l’anti-discrimination par la notion de diversité, elles ont réduit le recours au droit et, dans certains cas, les enjeux posés par l’existence des discriminations à une simple fonction d’affichage.
Une dernière question : votre travail repose sur une étude scientifique méticuleuse. Est-il possible de « convaincre » ceux qui doutent de l’existence des processus d’ « assignation racialisante » ? Faut-il expérimenter les discriminations pour les mieux combattre ?
S. M. : C’est une question complexe. Je ne sais pas s’il est possible de convaincre quelqu’un qui doute de l’existence des assignations racialisantes.
Et on pourrait dire cela d’autres formes de minorisations. Allez par exemple convaincre de la nécessité d’agir encore pour l’égalité hommes/femmes quand cette personne nie la persistance du problème.
Après, ce que l’on peut faire c’est rendre ce type de positionnement inadmissible. Et pour cela, il faut s’efforcer de relever sans cesse les cas d’assignation et de discrimination, de façon à mettre en lumière l’ampleur du problème et à donner toujours plus de légitimité à cette question et aux victimes de ce type de traitement.
Et pour ce qui est de l’ultime point que vous soulevez, l’expérience est capitale et irremplaçable, mais malheureusement, elle ne suffit pas.
Vous avez des personnes soumises à des formes d’assignation qui vont être dans le déni de leur expérience ou ne pas supporter que ce qu’elles vivent comme une expérience personnelle et épisodique soit généralisable et puisse être rapporté aux rapports de pouvoir qui structurent la société (et là encore on peut faire le parallèle avec les formes de résistance que certaines femmes opposent au féminisme).
C’est en ce sens que le combat contre les discriminations passe aussi par une politisation. Mais pour que cette politisation se fasse, il faut que l’expérience de l’assignation racialisante puisse se dire et que la mise en commun des expériences soit possible.
C’est pour cela qu’il est nécessaire que des espaces où les personnes soumises à des assignations racialisantes puissent se retrouver et parler sans que le récit de leur expérience soit remis en doute.
En d’autres termes, à côté de moments où la parole est donnée à tout.e un.e chacun.e, quelle que soit son expérience au regard de la racialisation, il faut aussi des espaces de non-mixité qui permettent la politisation de l’expérience par celles et ceux qui sont soumi.s.e quotidiennement à des formes d’ « assignation racialisante ».
Propos recueillis par Nadia Henni-Moulaï
Sarah Mazouz, sociologue, chargée de recherche au CNRS (CERAPS), a publié La République et ses autres. Politiques de l’altérité dans la France des années 2000, (Lyon ENS Éditions, 2017) , co-auteur de Réprimer, Accompagner. Essai sur la morale de l’État, Paris, Seuil, 2013 ainsi que de At the Heart of the State. The Moral World of Institutions, Londres, Pluto Press, 2015.