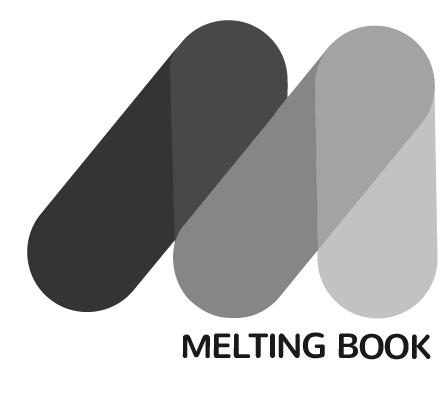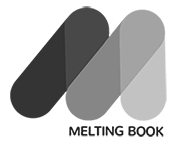Laïcité(s) : Faut-il changer la loi de 1905 ?
[#Série d’analyses]
MeltingBook publie en exclusivité une série de 10 analyses tirées du livre : Abécédaire du jihadisme post-daesh : Analyses Témoignages Perspectives (2018). Un ouvrage collectif sous la direction de Moussa Khedimellah.
La cinquième analyse : celle de Chloé Mathieu, docteur en droit public. Elle disséque le principe de laïcité à la lumière du contexte français.
Tantôt présentée comme un glaive, tantôt présentée comme un bouclier, la laïcité aujourd’hui
divise toujours autant que lors de l’adoption de la loi de 1905 (1). Ainsi qu’il ressort de ses deux
premiers articles, la laïcité est un principe de séparation entre le politique et le religieux, entre
l’Etat et les églises, qui emporte trois conséquences complémentaires. A l’égard des citoyens
français, la laïcité assure la liberté de culte et de conscience (celle, donc, de croire ou de ne
pas croire) – sous réserve du respect de l’ordre public (2) –, y compris dans l’espace public, sans
qu’aucune sorte de discrimination ne puisse être mise en œuvre par l’Etat en raison de leurs
croyances.
>> À LIRE SUR MELTINGBOOK :
Les autres analyses du livre collectif : Abécédaire du jihadisme post-daesh : Analyses Témoignages Perspectives (2018), sous la direction de Moussa Khedimellah
« Hûr ‘în » les 72 vierges du Paradis, Fantasmes et stratégie de com de Daesh
A l’égard de l’Etat ensuite, la laïcité emporte tant une émancipation vis-à-vis de la
religion qu’un devoir, celui d’être neutre et impartial vis-à-vis de toute croyance religieuse.
Enfin, la laïcité postule le principe d’autonomie des Eglises vis-à-vis de l’Etat et trace une
frontière nette entre les sphères d’actions politique et religieuse, obligeant les Eglises à se
retirer de la première pour se cantonner à la seconde.
Brève histoire de la laïcité en France
Avant même la loi de 1905, c’est le Directoire qui, le premier, met fin à la confusion entre les
ordres politiques et religieux sur laquelle reposait l’Ancien Régime. La Constitution de l’An
III prévoit en effet que « Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le
culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un lieu de culte. La
République n’en salarie aucun » (3). Le Concordat, conclu en 1801 entre Napoléon et le Vatican,
revient sur cette séparation de manière nuancée : si le catholicisme n’est plus reconnu comme
la religion d’Etat (4), le Concordat reconnaît quatre cultes (catholique, réformé, luthérien,
israélite) qui étaient alors organisés en services publics du culte, et l’Etat avait à sa charge le
traitement des ministres du culte et participait à leur désignation. Ce n’est qu’en 1905 que la
loi instaure, durablement, la séparation entre les Eglises et l’Etat, principe qui figure
aujourd’hui dans la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » (5). Les cultes cessent ainsi
d’être des institutions publiques et relèvent du droit privé, en étant remplacés par des
associations cultuelles.
Or, en se séparant du religieux, dans lequel il puisait auparavant sa légitimité et son autorité,
l’Etat se doit de se réinventer afin de pallier le défaut de légitimité – et de transcendance – qui
résulte de sa séparation d’avec la religion dominante d’alors. Et, bien que le XXe siècle ait
montré que d’autres doctrines pouvaient, avec les conséquences que l’on connaît, remplir le
même rôle que la religion, le « désenchantement du monde » brillamment décrit par Max
Weber plonge la France et, plus généralement, les Etats européens dans une quête de
légitimité qui, aujourd’hui encore, n’apparaît pas résolue, faute de vision fédératrice de la
communauté nationale.
Des quelques dérogations législatives à la séparation des Eglises et de l’Etat : la question du financement des cultes et lieux de culte
Depuis que la loi de 1905 a déplacé les Eglises et les cultes de la sphère publique à la sphère
privée, les associations cultuelles ne peuvent plus recevoir de subventions publiques, qu’elles
soient directes ou indirectes. Ainsi, pour faire face aux dépenses nécessaires à leur
fonctionnement, les Eglises peuvent – et doivent – donc avoir recours à des ressources et
financements privés issus de dons, de cotisations, de rétributions des cérémonies, … Des
dérogations ont toutefois été consenties (6).
Certaines l’ont été dans le sillon de la loi de Séparation. Ainsi, l’Etat et les collectivités
locales demeurent propriétaires d’un certain nombre d’édifices religieux, bâtis avant 1905 ou
reconstruits après l’une des deux guerres mondiales, lesquels sont alors mis gratuitement à la
disposition des diocèses, conformément à la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public
des cultes. Pour ces bâtiments, qui relèvent du domaine public, les travaux nécessaires à
l’entretien et à la salubrité sont donc pris en charge, financièrement, par l’Etat et les
collectivités qui en sont les propriétaires, constituant par là même un véritable avantage
financier pour la communauté catholique, le plus souvent justifié par la nécessité d’entretenir
et de préserver le « patrimoine culturel » de la France. Par ailleurs, ainsi que le prévoit la loi
de 1905, l’Etat continue également d’assurer les dépenses relatives à « des services
d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics
tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons », lorsqu’il s’agit
d’établissements publics.
Plus récemment, le législateur a adopté un certain nombre de dispositions bénéficiant à
l’ensemble des cultes. Ainsi, les établissements d’enseignement privé peuvent bénéficier
d’aides publiques lorsqu’ils passent un contrat avec l’Etat. Les entreprises et particuliers
réalisant un don auprès d’une association cultuelle déclarée peuvent bénéficier d’une
déduction d’impôt. Les édifices affectés au culte sont également exonérés de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti lorsqu’ils appartiennent à l’Etat, à une
collectivité locale ou à des associations cultuelles. Enfin, l’Etat a la possibilité d’accorder sa
garantie à des emprunts émis par les associations cultuelles et les communes accordent de
plus en plus de baux emphytéotiques à ces dernières, en échange d’un loyer symbolique.
Ainsi, s’agissant du financement des cultes et lieux de culte, la France se distingue de la
plupart de ses homologues européens. Car au-delà de la participation indirecte à ce
financement, par le biais de subventions, qu’assure également la France, les Etats européens
ont quant à eux fait le choix de participer directement au financement des communautés
religieuses. C’est le cas, par exemple, en Belgique, où la Constitution prévoit que la
rémunération des ministres du culte est assurée par l’Etat, qui prend également en charge les
pensions de retraite de ces derniers, en raison de leur « utilité sociale ». En Espagne et en
Italie, il a été prévu que les contribuables ont la possibilité d’affecter une partie de leur impôt
à l’Eglise catholique, en Espagne, ou à toute communauté religieuse ayant signé un accord
avec l’Etat en Italie, de manière à ce que les cultes ne soient financés que par les
contribuables qui le désirent, et non plus par la totalité d’entre eux. Enfin, l’Allemagne et le
Danemark ont notamment mis en place un impôt cultuel, et les Eglises – ou certaines d’entre
elles – reçoivent également des subventions directes.
Le choix de la France en matière de non-financement des lieux de culte, résultant
essentiellement de la loi de 1905, pose, de facto, la question du financement du culte
musulman. En effet, l’interdiction pour les personnes publiques de financer les lieux de cultes
en dehors de certaines exceptions bénéficiant, pour leur quasi-totalité, aux édifices chrétiens,
conduit les pratiquants du culte musulman à devoir financer eux-mêmes les mosquées. Or, au
vu du coût d’entretien et, surtout, de construction de tels bâtiments, les fonds des associations
et le produit des quêtes sont souvent insuffisants. Il est donc souvent fait appel à des mécènes
étrangers pour réaliser de tels investissements, ce qui ne va pas sans entraîner un certain
nombre de problématiques, au premier rang desquelles l’origine et la traçabilité des
financements, en grande partie due au fait que les associations qui recueillent les dons –
publics ou privés – ne sont pas soumises à l’obligation de rendre publics leurs comptes.
Plusieurs Etats étrangers ont toutefois accepté de rendre publics les dons réalisés en vue de la
construction de mosquées sur le sol français. Ainsi, à titre d’exemple, entre 2011 et 2016,
l’Arabie Saoudite a dépensé plus de 3,7 millions d’euros pour financer la construction de huit
mosquées en France. Si l’origine des fonds ne pose, en elle-même, aucun problème, il n’en va
pas de même pour l’influence potentielle des investisseurs sur le fonctionnement de la
mosquée, le choix des imams et, partant, des prêches. Si davantage de transparence est
évidemment souhaitable, l’interdiction des financements étrangers est difficilement
envisageable, précisément du fait de la loi de 1905 et du principe de laïcité tel qu’il en
découle.
La laïcité française : un principe, deux conceptions
Glaive ou bouclier, laïcité « ouverte » ou laïcité « fermée », les expressions sont nombreuses
et témoignent de la pluralité et de l’antagonisme des conceptions de la laïcité et des
présupposés sur lesquels se fondent ceux qui l’invoquent.
C’était déjà le cas au XXe siècle, durant lequel se sont opposés les tenants de la « laïcité-
séparation » et les tenants de la « laïcité-neutralité ». Pour les premiers, la religion est à
l’origine d’une vision obscurantiste de la société et de la persécution des communautés
minoritaires. La séparation des églises et de l’Etat est donc l’occasion de reléguer ces vices
consubstantiels à la religion au passé ; elle signe le « début de la fin » de la religion,
indispensable pour permettre à l’intérêt général de ce construire. Pour les tenants de la laïcité-
neutralité, l’obscurantisme et les persécutions sont contingents et doivent être distingués de la
dimension spirituelle de la religion. La séparation entre les églises et l’Etat est l’occasion pour
ce dernier de renouer avec la transcendance en se positionnant en arbitre neutre d’un point de
vue religieux, et en se donnant pour mission de préserver la liberté de croyance et de s’assurer
que les religions ne réinvestissent pas la sphère politique dont elles sont désormais exclues.
Aujourd’hui, l’opposition entre ces deux conceptions continue d’agiter le débat public à
l’occasion des débats relatifs au port de certains signes religieux ostentatoires ou à la
manifestation de l’appartenance à une religion dans l’espace public : port du voile à
l’université ou par les mères accompagnant leurs enfants lors de sorties scolaires, port du
burkini sur les plages, menus halal ou casher dans les établissements scolaires, installation de
crèches dans les établissements publics, prières dans la rue… Pour les tenants de la laïcité
« ouverte », héritière de la « laïcité-neutralité », l’Etat doit se contenter de s’assurer de la
neutralité de ceux qui représentent – de près ou de loin – le pouvoir politique (élus,
administrations publiques et entreprises bénéficiant d’une délégation de service public). En
revanche, pour les tenants de la laïcité « fermée », héritiers des « laïquards », l’Etat doit
s’employer, en vertu du principe de laïcité, à faire de l’espace public un espace neutre en
proscrivant toute manifestation d’appartenance religieuse.
C’est donc, avant tout, le critère d’applicabilité du devoir de neutralité religieuse qui
différencie ces deux conceptions de la laïcité : les tenants de la laïcité ouverte estiment que le
devoir de neutralité s’applique aux représentants du pouvoir politique, laissant les citoyens
libres d’exprimer et de manifester leurs croyances dans l’espace public – sous réserve du
respect de l’ordre public. Le principal reproche adressé aux tenants de cette conception réside
dans sa complaisance à l’égard de certaines manifestations d’appartenance religieuse. Pour les
tenants de la laïcité « fermée », le devoir de neutralité ne s’applique plus à une catégorie de
personnes (les représentants du pouvoir politique), mais à un lieu figuré, celui de l’espace
public, au sein duquel quiconque doit apparaître neutre en s’abstenant de manifester et, a
fortiori, de faire valoir ses croyances religieuses. A cette conception, il est reproché de ne
retenir de la loi de 1905 et de la laïcité que le principe de neutralité, et ce au détriment de la
liberté de conscience et du droit d’exercer librement son culte.
Islam et réactivation de l’opposition entre les deux conceptions de la laïcité
Un temps disparue, la visibilité de l’opposition entre les conceptions de la laïcité « fermée » et
« ouverte » a été réactivée, en France, en grande partie sous l’effet de l’augmentation du
nombre de musulmans à la fin du XXe siècle et, plus précisément, de l’augmentation
supposée du nombre de musulmans portant des signes ostentatoires de leur appartenance à
l’islam. Le législateur et le pouvoir réglementaire sont alors intervenus à plusieurs reprises, en
s’appuyant plus ou moins ouvertement sur le principe de laïcité, afin de limiter le port de
certains signes religieux ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics (en 20047 et
en 20128), au sein de la fonction publique (en 20079), dans l’espace public (en 201010).
Les débats suscités par l’une des dispositions du projet de loi El Khomri, adopté en 2016,
illustrent les difficultés et, parfois, le malaise que suscitent les questions relatives à la laïcité et
à la manifestation de ses convictions religieuses, en l’espèce au sein des entreprises. Dans sa
version originelle, le projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait que seuls l’exercice
d’autres libertés ou les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise peuvent justifier des
limitations au principe que constitue la « liberté du salarié de manifester ses convictions, y
compris religieuses » au sein de l’entreprise (11). Or, et bien que cette disposition se limite à
rappeler le droit actuel, elle a suscité bon nombre de réactions de la part des parlementaires,
lesquelles peuvent être résumées par cette intervention de Pierre Burban, secrétaire général de
l’UPA durant les débats en commission : « En ce qui concerne la laïcité, l’article 1er ne fait
effectivement que reprendre la jurisprudence actuelle. Mais voir cela écrit noir sur blanc, c’est
tout de même autre chose, et cela suscite beaucoup d’inquiétudes »1213.
A l’origine de ces « inquiétudes » évoquées par Pierre Burban, voire, parfois, d’une certaine
hostilité, se trouve la multiplication des manifestations d’appartenance à une religion
relativement nouvelle en France, l’islam. Car, pour certains, le voile, le niqab (voile intégral)
ou, plus récemment, le burkini sont autant de manifestations ostentatoires de l’appartenance à
la religion musulmane qui nécessiteraient de revenir – si tant est qu’elle ait déjà abandonnée –
à une conception de la laïcité fermée, réactivant ainsi le clivage entre les deux conceptions de
la laïcité. Toutefois, du fait de la difficulté de lutter contre le port de ces signes religieux dans
l’espace public sur cette seule base, précisément en raison de l’absence d’univocité de la
notion de laïcité, d’autres principes juridiques sont fréquemment invoqués : défense de la
liberté et de la dignité de la femme, risques d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, respect
du principe d’égalité, etc.
Les principes de laïcité et de neutralité, sources potentielles de discrimination ?
Le durcissement de l’exigence de laïcité et de neutralité ne se limite aujourd’hui pas à la
sphère publique. En effet, les contentieux relatifs au port des signes religieux entre employés
et employeurs se multiplient. Or, pour certains, la tendance normative croissante à « durcir »
l’exigence de neutralité dans les espaces public et privés, bien qu’elle s’appuie notamment sur
la laïcité, heurte un autre principe, celui de non-discrimination, dans la mesure où elle viserait
plus spécifiquement une religion, l’islam. La Cour de justice de l’Union européenne, dans une
affaire récente, résume bien la difficulté à trancher entre l’une et l’autre de ces positions. En
effet, les juges de Luxembourg (14) estiment que le port visible d’un signe religieux sur le lieu de
travail peut être proscrit par le règlement intérieur d’une entreprise sans que cela constitue une
discrimination directe (15). Ils précisent, en revanche, qu’une telle règle interne d’une entreprise
privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte s’il est établi que l’obligation
en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les
personnes adhérant à une religion particulière, sauf si elle est objectivement justifiée par un
objectif légitime, comme la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients,
d’une politique de neutralité religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif sont
appropriés et nécessaires ». Dans une décision en date du même jour (16), la Cour rappelait
également que, dans l’hypothèse où le règlement intérieur d’une entreprise ne le prévoit pas,
l’employeur ne peut interdire à une salariée de porter le foulard islamique que lorsque cela est
justifiée par la nature de la tâche à accomplir et répond à une exigence professionnelle
essentielle et déterminante. Ce faisant, elle a précisé que la prise en compte des souhaits d’un
client ne répond pas à ces conditions.
La nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne
ainsi que les réponses de ladite Cour illustrent les difficultés qu’est susceptible de poser
l’application concrète du principe de laïcité ou sa déclinaison hors l’espace public, le principe
de neutralité. La notion de discrimination indirecte, notamment, témoigne de ce que, sous les
apparences d’une exigence de neutralité, la laïcité peut également, selon les intentions de celui
qui l’exige et les effets qu’elle engendre, créer une différence de traitement entre croyants ou
entre croyants et non-croyants.
La laïcité, arme au service de l’islam politique ?
A côté des accusations consistant à faire de la laïcité – dans sa conception « fermée » – un
facteur de discrimination à l’égard de la communauté musulmane, certains estiment au
contraire que la laïcité est instrumentalisée par certaines communautés et, plus
spécifiquement, par les tenants d’un islam politique. Plus précisément, ces derniers
s’appuieraient d’abord sur la laïcité pour encourager la communauté musulmane à manifester
sa foi de manière toujours plus ostensible, quitte à faire du prosélytisme religieux. Ils
s’appuieraient également sur les limitations et interdictions posées par le principe de laïcité –
notamment la limitation tenant au respect de l’ordre public – pour exacerber les sentiments
d’exclusion et d’oppression sociétales. La revendication de l’appartenance à une communauté
– religieuse en l’occurrence – entraînerait une sorte d’émulation autour de croyances perçues
comme menacées par la soumission aux valeurs de la République.
Ceux qui adoptent cette position souhaitent alors, le plus souvent, modifier les normes
d’application du principe de laïcité, pour aller vers une conception davantage « fermée », ou
davantage hostile à toute manifestation d’appartenance à une communauté religieuse et, plus
spécifiquement, à la communauté musulmane. Le durcissement de la laïcité contribuerait ainsi
à lutter contre un extrémisme religieux insidieux, en interdisant de manière plus ou moins
largement tout port de signe religieux, et tout refus des pouvoirs publics d’aller dans ce sens
renforcerait la détermination des communautaristes.
Pour une laïcité partagée : renouer avec les racines humanistes
La laïcité n’est pas, loin s’en faut, un principe qui suscite l’unanimité en France, et si
consensus sur celle-ci il y a eu, il a été de courte durée. Dans un certain sens, cette tension qui
entoure la compréhension et la détermination du contenu du principe de laïcité est
compréhensible, dans la mesure où il s’agit d’un principe qui soulève bon nombre de
questions tenant au vivre ensemble, et ce dans l’ensemble des champs de l’espace et de la vie
publics, dont certains sont symboliquement forts : école (menus à la cantine, accompagnants
scolaires, université, …), services publics, … La laïcité pose également un certain nombre de
questions qui concernent l’ensemble de corps social, à l’instar des limites de la tolérance, de
la liberté de conscience, de la nécessité et des moyens de préserver l’histoire et la culture
françaises ou encore de l’intégration.
Mais, ainsi que l’a rappelé l’Observatoire de la laïcité en 2016 (17), la laïcité est avant tout une
liberté et une garantie du principe d’égalité. Elle est la liberté de croire ou de ne pas croire, et
entend garantir l’absence de discriminations fondées sur les croyances ou pratiques
philosophiques et religieuses. Ainsi, la laïcité est et demeure, intrinsèquement, un principe
humaniste. Il correspond parfaitement, de ce fait, à la devise de la République française
« Liberté, Égalité, Fraternité ».
Les difficultés ne découlent donc pas tant du principe de laïcité que de ses applications et de
ses interprétations. Parce-que ces dernières supposent de parvenir à trier ce qui relève de la
libre expression de ses convictions et ce qui relève du prosélytisme, entre ce qui relève de
l’exigence légitime de neutralité et ce qui constitue une discrimination, ou encore entre ce qui
traduit un manque de tolérance et ce qui suggère une provocation et un encouragement au
communautarisme. La définition des implications du principe de laïcité nécessite ainsi de
trouver un équilibre et, partant, d’arbitrer entre les différentes conceptions de la laïcité, dont
chacune est basée sur une appréhension particulière de la religion dans son ensemble, de
chacune des religions en propre, du vivre ensemble et de la tolérance. Or, un nouvel équilibre,
différent de celui établi par les textes de lois ou les règlements postérieurs à la loi de 1905, ne
saurait être trouvé tant que la société française n’a pas mené à son terme l’exercice
d’introspection nécessaire à son apaisement, sans lequel les conditions du vivre ensemble ne
peuvent être réunies.
La loi de 1905, un socle immuable
En l’état, la loi de 1905 ne constitue que – mais c’est déjà beaucoup – le socle du principe de
laïcité. Elle prévoit que les Français sont libres de croire ou de ne pas croire et que, lorsqu’ils
croient, ils sont libres de manifester leur croyance, à partir du moment où leurs pratiques ne
viennent pas porter atteinte à l’ordre public. Parallèlement, elle prévoit que l’Etat doit
demeurer neutre et impartial à l’égard des « enfants de la République », et ce quelles que
soient leurs croyances. La loi de 1905 doit donc demeurer le socle immuable qu’elle incarne
aujourd’hui pour le principe de laïcité.
Par Chloé Mathieu
Photo de Une : © Concours de dessin Cité Scolaire de Nay, 2016.
NOTES :
(1) Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
(2) Cette limite, mentionnée par la loi de 1905, apparaît dès 1789 dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (article 10).
(3) Article 354 de la Constitution de l’An III.
(4) Le catholicisme redevient, temporairement, la religion d’Etat entre 1814 et 1830.
(5) Alinéa 1 de l’article 1er de la Constitution de 1958. La Constitution de 1946 prévoyait également, dans son préambule, que « le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
(6) Ne sont évoquées ici que les principales dérogations, certains territoires, qu’il s’agisse de territoires outre-mer ou de territoires métropolitains spécifiques, à savoir les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, bénéficiant de dérogations supplémentaires.
(7) Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
(8) Voir notamment la circulaire 2012-056, dite « circulaire Chatel », du 27 mars 2012.
(9) Circulaire n° 5209/SG du 13 avril 2007 relative à la charte de laïcité dans les services publics.
(10) Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public.
(11) Article 1er du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, qui précise également que les limitations à la liberté du salarié de manifester des convictions doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi. Cet article visait à énumérer les « les principes essentiels du droit du travail » destinés à guider les travaux de la commission d’experts et de praticiens nommée par le Gouvernement en vue de la refondation de la partie législative du Code du travail.
(12) Rapport n°3675 de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale en première lecture (p.139).
(13) En effet, nombreux ont été les parlementaires à estimer que cette disposition risquait de « cristalliser les inquiétudes » et d’éclipser la « philosophie générale » du projet de loi (voir notamment le rapport n°3675 de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale en première lecture).
(14) Arrêt n° C 157/15 du 14 mars 2017, Samira Achbita, c./ G4S Secure Solutions NV, en réponse à une demande de question préjudicielle de la Belgique.
(15) Au sens du droit de l’Union européenne et, plus précisément, au sens de la directive 2000/78 CE, dont les deux premiers articles prévoient notamment que constitue une discrimination directe le fait de traiter une personne « de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable » pour des motifs tenant à « la religion ou les convictions, l’handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ».
(16) Arrêt n° C-188/15 du 14 mars 2017, Asma Bougnaoui, c./ Micropole SA, en réponse à une demande de question préjudicielle de la France.
(17) Déclaration pour la laïcité, 3 octobre 2016.